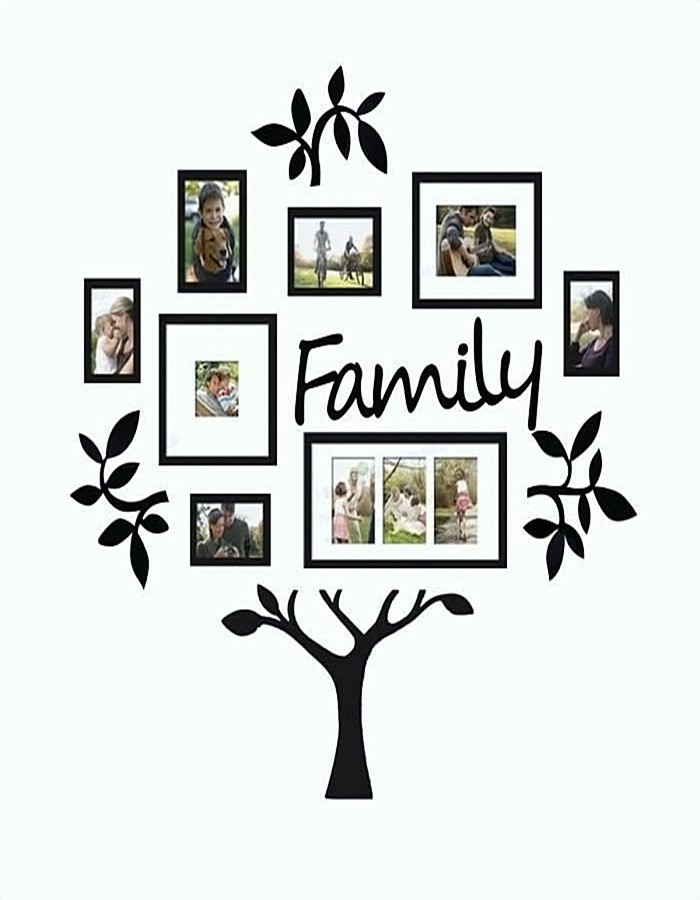Louis Lenglet x Sophie Pierrard
Le 1ᵉʳ avril 1774, à Bertry (Nord), naît Louis Joseph Lenglet.
À peine a-t-il poussé son premier cri qu’il est présenté aux fonts baptismaux, conformément aux usages d’Ancien Régime. À cette époque, les curés consignent les naissances, mariages et décès dans les registres paroissiaux, une mission qui perdurera jusqu’à la mise en place de l’état civil en 1792, au lendemain de la Révolution française.
Lenglet... comme moi !
Oui, mais pas si vite ! Car si nos noms de famille se ressemblent, le lien de parenté qui nous unit est plus ténu qu’il n’y paraît. Selon les calculs d’Hérédis, Louis est « simplement » le beau-frère du grand-oncle de mon arrière-grand-mère. En d’autres termes, nos liens de sang passent par une alliance et non par une lignée directe. La connexion véritable repose sur un autre couple, Martin Massel et Jeanne Leclerc, sans rapport avec notre patronyme commun.
Généanet, quant à lui, nous accorde un modeste 0,01 % de parenté – une poussière généalogique, mais qui suffit à nous inscrire, lui et moi, dans une même toile d’ancêtres entremêlés.
Certains généalogistes retranscrivent son nom en Langlet, une orthographe qui perpétue celle de son grand-père, Jean François Langlet, originaire de Clary. Une énième preuve que l’orthographe des noms de famille a longtemps été une affaire de phonétique et d’interprétation des scribes plus que de rigueur administrative.
C’est au bourg de Cateau-Cambrésis, ou plus familièrement du Cateau, que Louis trouve l’âme sœur. Il épouse en effet, à 27 ans, Sophie Pierrard, une jeune femme de 21 ans.
Une famille, un moulin entre Bertry et Le Cateau
Pour la majorité des habitants du Cambrésis, l’existence est intimement liée à l’industrie textile, mais Louis embrasse une autre voie : il suit la voie tracée par son père : il devient meunier. Cette profession, essentielle à la survie des communautés rurales, place les meuniers dans une position stratégique, au carrefour des échanges agricoles et des besoins des populations.
Sous l’Ancien Régime, les moulins à vent, bien que présents en France depuis le XIIᵉ siècle, nécessitent un investissement considérable pour leur construction et leur entretien. Jusqu’à la Révolution, seuls les seigneurs locaux ou les établissements religieux ont les moyens de les financer. Les meuniers ne sont donc pas propriétaires de leur moulin, mais de simples utilisateurs d’un moulin banal, relevant du monopole seigneurial.
Le meunier doit reverser au seigneur une partie du grain qui lui est confié. Quant à sa rémunération, elle provient du droit de mouture, soit une ponction d’un vingt-quatrième de la farine moulue… en théorie. Car la tradition populaire accuse souvent les meuniers d’« avoir la main lourde » et d’arrondir discrètement leur part.
L’amour du métier, qui faisait toute la fierté du meunier, se transmettant généralement de père en fils se retrouvait aussi dans le choix des épouses : il était fréquent qu’un meunier cherche femme parmi les filles de meuniers. Le père de Louis Lenglet ne fit pas exception à cette règle : il épousa Marie Anne Mouton, elle-même fille de meunier.
Louis Lenglet ne vivra pas à Bertry : il établit son domicile au Cateau où naitront six de ses enfants.
- Martin, né en 1802,
- Victoire, née en 1807,
- Henri Désiré, né en 1814,
- Nicolas Ildefonse, né en 1818,
- Jean, né en 1820,
- Ferdinande, née en 1823.
Une seule enfant naîtra à Bertry : Marie Thérèse Joseph Sophie, venue au monde en 1812, signe que la famille conserve des attaches avec son village d’origine.
Le Moulin Lenglet, photo ci-contre, exploité par Louis et Antoine, se trouvait sur la route de Troisvilles, au lieu-dit Riot de la Louvière.
Mais au fil des décennies, le paysage économique se transforme. Avec l’essor des minoteries industrielles, les petits moulins traditionnels perdent de leur importance et beaucoup disparaissent. C’est ce qui arrivera au Moulin Lenglet, qui cessera son activité au début du XXᵉ siècle.
Après des années passées sur la route entre Le Cateau et Bertry, le couple est revenu vivre au village. Louis Lenglet s’éteint à l’âge de 58 ans, le 22 mars 1833, en son domicile de la rue de Fervaque, aujourd’hui connue sous le nom de rue Gustave Delory.
Sa veuve, Sophie Pierrard, refera sa vie avec Aimé Vienne et poursuivra son existence entre Le Cateau et Bertry. Elle décédera le 20 mars 1856 au Cateau. L’acte de décès mentionne qu’elle est morte à l’âge de 80 ans, alors qu’en réalité, elle n’en comptait que 75. Une approximation administrative assez courante à l’époque où beaucoup de personnes ignoraient leur âge exact.
Après la parution de cet article, j’ai obtenu des informations complémentaires sur la vie de leurs enfants. Vous pouvez les retrouver dans un article ICI

Merci pour cette lecture. L' article vous a ému, intéressé, amusé ou tout simplement été utile ?
Ecrivez-moi un petit commentaire, Seul le nom (initiales ou pseudo) est obligatoire. Si vous souhaitez que je vous contacte, pensez-à renseigner votre e-mail, je suis toujours heureuse d'échanger .
Le blog ne comporte pas de bouton « like » aussi n’hésitez pas à manifester votre satisfaction au moyen des cinq étoiles ci-dessous. C’est une autre façon d’encourager mon travail !
Date de dernière mise à jour : Mer 19 mars 2025
Ajouter un commentaire